Quinze ans après, le constat est implacable : aucune de ces promesses n’a été tenue. Voici pourquoi.
Jusqu’à Sarkozy, on pouvait encore faire de grands discours sur le numérique. Le quinquennat Hollande marque le moment où il devient nécessaire d’agir. Mais l’équipe arrivée au pouvoir n’a pas de véritable vision, et c’est toute une génération de militants qui se retrouve aux commandes du numérique.
Avec l’élection d’Emmanuel Macron, les projets du numérique d’État continuent tels quels, sans être remis en cause, parce qu’il s’intéresse surtout aux startups. Pour susciter son intérêt, de nombreux services vont d’ailleurs « start-upiser » leur mode de fonctionnement, en oubliant que le numérique d’État intègre implicitement trois promesses qu’il faut tenir.
1. Une promesse de réduction des coûts
Quand on parlait d’informatique dans les années soixante-dix et quatre-vingt — ce qui a disparu aujourd’hui dans les discours des consultants —, l’informatique promettait une baisse des coûts.
Quand on numérise — et quand l’État numérise ses services —, cela devrait par essence coûter moins cher à opérer grâce à un accès facilité aux données. Mais ça, c’est une théorie, quand les choses sont bien faites et fonctionnent correctement.
Mais comme, depuis les années 90, la France a viré ses informaticiens, elle ne sait plus faire par elle-même. De nos jours, derrière les grands projets de la DINUM se cachent souvent des freelances recrutés sur Malt.
La plus grande erreur des années 90 n’était pas la désindustrialisation des fleurons technologiques de la France, ni leur vente aux Chinois ou aux Américains (c’est la deuxième), mais d’avoir expliqué que les ingénieurs et les informaticiens n’avaient plus leur place au sein de l’État, et de les avoir poussés à aller dans les cabinets de conseil ou, pour les meilleurs d’entre eux, dans la Silicon Valley, travailler pour les GAFAM.
Aujourd’hui, ce sont les cabinets de conseil qui développent l’infrastructure numérique de l’État, à des coûts évidemment bien plus élevés que si les ressources étaient internalisées. Et c’est l’infrastructure cloud des GAFAM — construite aussi en partie par des informaticiens français — qui pèse lourdement sur les finances publiques.
La question polémique qu’on pourrait se poser est la suivante : et si l’on embauchait une élite de développeurs super pros pour fixer le numérique d’État, serait-ce plus efficace et plus rentable que de continuer à utiliser des cabinets de conseil dispatchés dans des projets mal cadrés, surtout à l’ère de l’IA ?
C’est l’une des questions qu’il faudrait poser pour 2027.
2. Nous n’avons pas réglé la dette temporelle de l’État envers ses citoyens
La deuxième promesse du numérique, c’est le gain de temps, et donc l’amélioration du service public.
C’est ce que prétend apporter Elon Musk avec le projet DOGE.
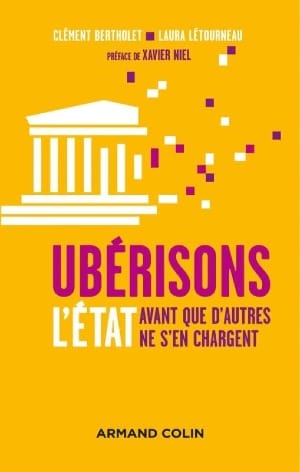
En France, nous n’avons pas le DOGE, nous avons l’« État plateforme ». Un concept dont une jeune génération d’idéologues d’un certain numérique s’est emparée. Leur prise en main de l’infrastructure publique n’a pas eu les effets promis — sauf pour leurs carrières, qui ont été largement boostées.
En effet, l’État plateforme n’a pas résolu la question de la dette temporelle, souvent plus insidieuse que la dette financière : ces centaines de millions d’heures perdues à cause de processus inefficaces, de sites essentiels comme l’URSSAF qui dysfonctionnent, obligeant les usagers à multiplier les appels téléphoniques ou à s’enfoncer dans des démarches kafkaïennes.
On aurait pu imaginer, si la volonté de simplification avait été réelle, une refonte complète de l’infrastructure numérique, plutôt que de calquer la complexité existante. Une génération née avec le smartphone aurait pu bénéficier d’un environnement administratif simplifié, centré sur le mobile, permettant de gérer l’ensemble de ses démarches avec l’efficacité d’un système bien conçu. Mais hélas, ce n’est pas le cas.
3. La souveraineté numérique oubliée
La troisième promesse non tenue, c’est celle de la souveraineté numérique. C’est-à-dire la capacité de l’État à fonctionner indépendamment des logiques géopolitiques, des guerres de plateformes, et des dépendances numériques actuelles.
Cela aurait supposé de développer en interne des compétences, de soutenir l’écosystème de startups de l’open source, et de susciter des alternatives crédibles aux GAFAM.
Mais après quarante milliards d’euros injectés dans la French Tech, et une dépendance aux GAFAM qui nous coûterait — selon Nicolas Dufourcq — plus de cent milliards (dans C Politique), le constat est clair : nous n’avons pas de souveraineté numérique.
Le numérique est avant tout un instrument de pouvoir
En Ukraine, le ministre de la Transformation numérique a le rang de vice-Premier ministre.
En France, le numérique n’a jamais été vu comme un outil d’émancipation, mais comme un levier de contrôle, notamment à travers l’usage du nudge très en vogue chez la gauche américaine et utilisé avec jubilation depuis quelques années en France.
Il y a quinze ans, lors de l’arrivée de François Hollande au pouvoir, il existait pourtant une véritable opportunité de changer les choses. Ceux qui ont vécu cette période et qui n’y sont plus aujourd’hui en gardent un sentiment d’amertume profond face au constat actuel.
Pourquoi cela n'a pas marché ?
En numérique d’État, il faut démarrer non pas par un cas d’usage, mais par une cible d’usage.
Commencer avec les early adopters, ce que j’appelle les « État-testeurs ».
Sinon, ce type d’expérimentations aboutit systématiquement à une « usine à gaz », comme dans le domaine de la santé, où l’on tente de faire rentrer tous les cas particuliers dans un moule standard.
Mais pour cela, il aurait fallu qu’à un moment, les fonctionnaires nommés à ces postes sortent de leur hubris et acceptent de ne pas tout savoir.
Pour les prestataires, l’État reste une vache à lait qu’il faut traire au plus vite, sans aucune sanction et sans aucune mesure réelle de la performance. Ce qui donne lieu à des situations ubuesques, où les produits ne sont même pas livrés, y compris pour des projets critiques de la police.
Il faut s’interroger, quand on lit le décret d’application de la DINUM — rédigé dans un autre temps, dans un autre Internet —, sur son obsolescence. Et se demander s’il ne faudrait pas tout repenser à l’ère de l’IA et des nouveaux enjeux numériques.
Pour ma part, je suis favorable à une réorganisation complète du numérique public en 2027, qui laisse une nouvelle génération de gens aux manettes.
En 2027, que doit-on enlever à l’État ?
Entre ceux qui prônent un DOGE à la française, et ceux qui persistent dans une vision obsolète du numérique d’État, il y a bien un entre-deux.
Le débat essentiel pour 2027 n’est pas « que faut-il ajouter à l’État ? », mais « que faut-il lui enlever ? » Pas en termes d’argent ou de personnel, mais de processus. Dans un monde en pré-guerre et post-vérité, la question de la souveraineté numérique ne peut plus être traitée par des girouettes idéologiques, mais par des professionnels.
Il y a trois ministères qui ont, pour l’instant, une stratégie qui semble fonctionner : Défense, Intérieur et Bercy.
Mais pour le reste, la stratégie numérique de l’État, tout comme les investissements privés, n’est pas à la hauteur. La question du renouvellement des idéologies, des personnes et des visions est désormais nécessaire. Espérons qu’elle sera au cœur de la question de 2027.
Suite réservée aux membres du Conseil de la résilience numérique (abonnez-vous!)
Lire l'article complet
S'inscrire maintenant pour lire l'article complet et accéder à tous les articles déstinés aux payants abonnés.
S'abonner




